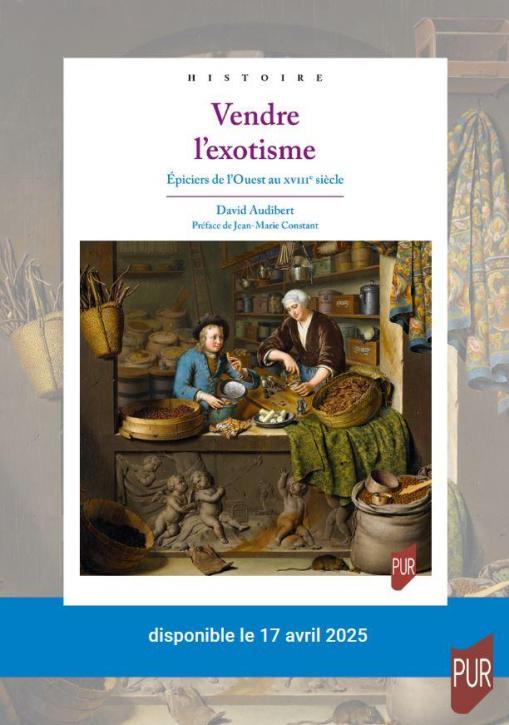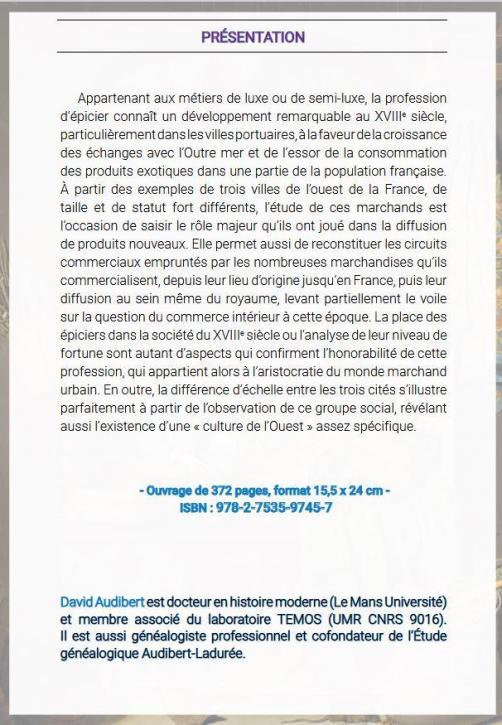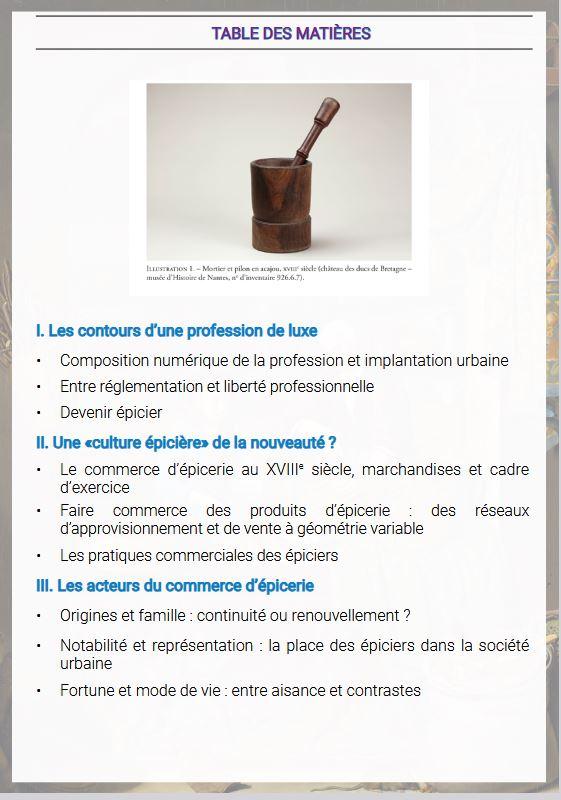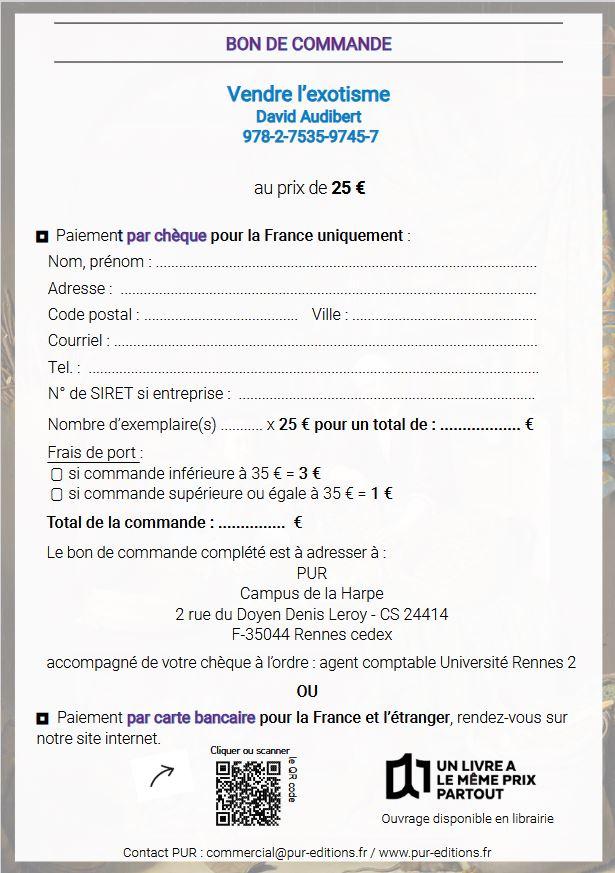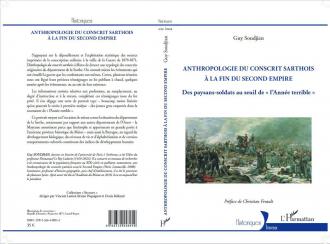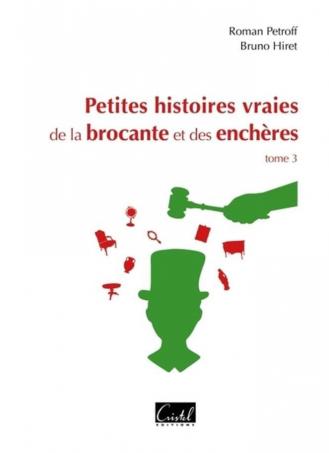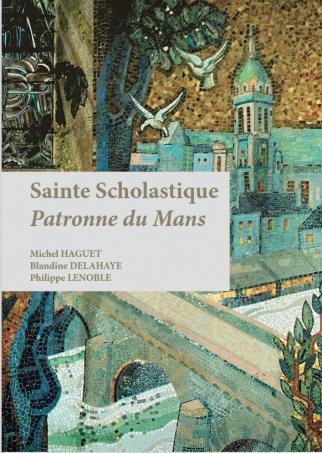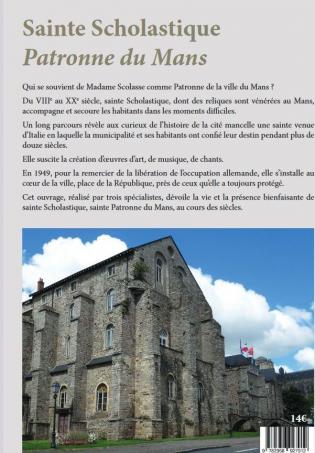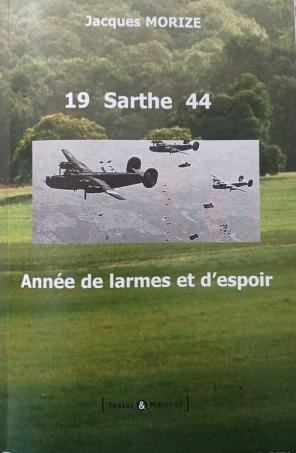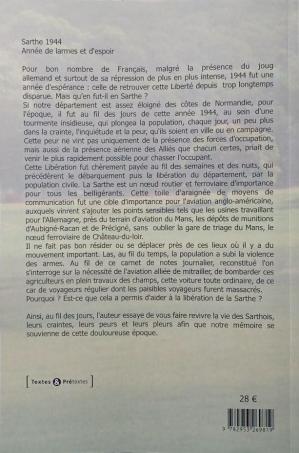Livres
Histoire de la Mafia au delà des Préjugés par Jean-Yves Frétigné
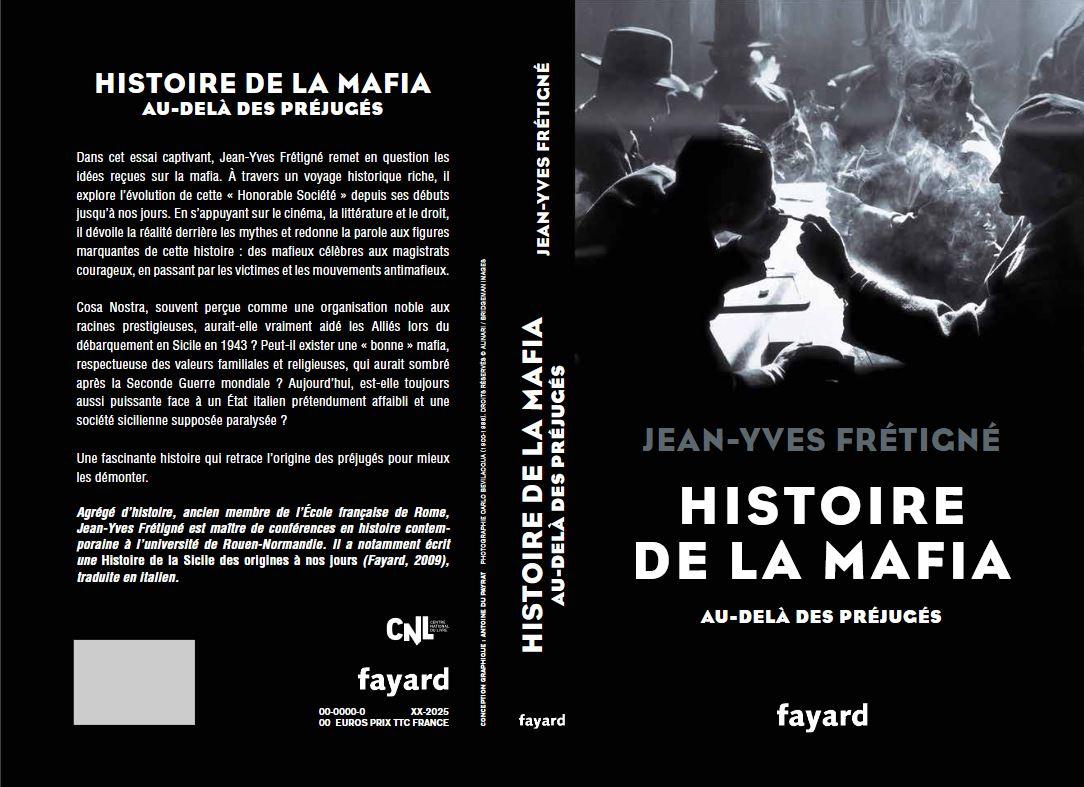
Épiciers de l'Ouest au XVIII -ème siècle par David AUDIBERT
Petites Histoires vraies de la brocante et des enchères, tome 3
Un gentilhomme du Vairais - Thierry Dubuisson
Pourquoi mon père revenait-il sans cesse sur le souvenir de sa ferme natale du Saosnois ? Il nous racontait les petits bonheurs et les grands malheurs qu'il y avait vécus. Mais cela n'expliquait pas l'attrait qu'exerçait sur moi ce domaine atypique du Vivier, situé aux marches du Perche, et dont l'histoire comportait de nombreux mystères. Pourquoi cette si grande cour fermée par des murs et ce petit arbre méditerranéen près de la maison ? Où menait ce souterrain ? Poussé par une étrange curiosité, je m'engageai dans l'escalier de la cave pour remonter le temps. J'y découvris des histoires issues des limbes du passé, comme celle du chevalier de Tascher, lointain cousin de l'impératrice et issu d'une grande famille du Perche. Gentilhomme voyageur, il fut à l'origine du château édifié sur ces lieux peu avant la Révolution et aujourd'hui en partie disparu.
Les Plantagenêts et le Maine
Situé sur un axe assurant la jonction entre Aquitaine au sud et le pôle anglo-normand au nord, le comté du Maine, contrôlé par la dynastie Plantagenêt depuis le début du XIIe siècle, occupe paradoxalement une place marginale dans l'économie et le pouvoir des comtes d'Anjou, devenus rois d'Angleterre avec Henri II. Cette situation stratégique en fait un cas d'étude remarquable : espace périphérique dans l'ensemble politique et économique Plantagenêts, le comté revêt cependant une importance capitale lors de l'affrontement entre Philippe Auguste et les souverains anglais. Les études ici réunies permettent d'éclairer les différents aspects de l'implantation, de la circulation et de la représentation d'un pouvoir qui ne fait bien souvent que traverser le comté mais n'y réside jamais de manière durable. L'exemple du comté du Maine permet de porter un regard neuf sur l'exercice du pouvoir dans l'ensemble plantagenêt, lui conférant ainsi une valeur exemplaire. Il invite à réexaminer les pratiques
du pouvoir en terme de représentation locale et de négociations avec les pouvoirs en place, révélant un équilibre subtil des forces en présence que les Plantagenêts s'efforcent de maintenir en leur faveur. C'est enfin l'occasion de mettre en lumière les dernières recherches concernant les éléments majeurs du patrimoine manceau, comme l'abbaye de l'Epau, l'hôtel-Dieu de Coëffort ou le portail royal de la cathédrale Saint-Julien du Mans, dans lesquels les souverains Plantagenets et leurs proches investissent, comme autant de jalons matériels de leur pouvoir.
La digue
" Jeanne nous a quittés il y a deux mois, emportée par une vague furieuse alors qu’elle faisait du bateau avec son frère aîné.
Elle venait juste d’avoir dix-huit ans. Malgré plusieurs jours de recherche en mer, son corps n’a jamais été retrouvé.
Ma fille est morte sous l’eau dans l’obscurité silencieuse, ensevelie sans funérailles. Et depuis, je vis l’absurde de la douleur qu’aucune logique ne parvient à surmonter. Chaque jour, je contemple le ciel sans espoir de ma vie brisée. J’ai le sentiment d’avoir tout perdu et de n’avoir plus rien à offrir."
Un mari omnipotent. Un fils soumis à l’emprise paternelle.
Une fille dont elle ne s’explique pas la disparition.
Un environnement étouffant. Virginie, au bord de l’épuisement, décide de tout quitter sans informer personne de sa destination.
Elle va s’exiler à La Digue, une petite île des Seychelles, pour tenter d’accepter la disparition de Jeanne, d’aller à la découverte de l’intime de soi et d’inventer une autre façon de conduire sa vie.
Parviendra-t-elle au cours de cette parenthèse paradisiaque à vaincre ses démons et à trouver la délivrance dans l’éloignement et la solitude ? Des rencontres improbables vont bousculer ses rêves et l’accompagner dans sa quête identitaire.
Jean-François Renault, orthophoniste, est né en 1949 et vit au Mans.
La Digue est son premier roman.
La fabrique d'une légende
Saint Julien du Mans et son culte au Moyen Âge (IXe-XIIIe siècle)
Mazel Florian (Directeur)
La figure « historique » de Julien du Mans demeure évanescente, pour ne pas dire insaisissable. Pourtant Julien finit par être considéré comme le premier évêque du Mans et un disciple des Apôtres, et par devenir le patron du diocèse du Mans. Ce livre expose l'ensemble des pratiques et des représentations que la fabrique légendaire met en jeu, à l'articulation de l'histoire de l'institution ecclésiale, de l'histoire culturelle et de l'histoire des pouvoirs. Pour mieux fonder la démonstration, l'ouvrage propose également une édition scientifique des principaux textes hagiographiques et liturgiques concernant saint Julien.
Avec le soutien de l'unité de recherche Tempora de l'université Rennes 2 et de l'Institut universitaire de France.
1481-1789 Du Haut-Maine à la Sarthe
Benoît Hubert, docteur en Histoire moderne, travaille sur les écrits du for privé, les élites urbaines au XVIIIe siècle , le monde de la cire et des ciriers, la culture et les mentalités négociantes à l'époque des Lumières. Il a publié Leprince d'Ardenay, Mémoires d'un notable manceau au siècle des Lumières, PUR (2007), Journal d'un chanoine du Mans, Nepveu de La Manouillère, PUR (2013) et Mémoires d'un villageois du Maine Louis Simon, PUR (2013).
Martine Taroni, docteur en Histoire moderne, est spécialiste des écrits du for privé, des questions religieuses, de l'Histoire de la Révolution française et particulièrement du Directoire.
Elle a publié François-Yves Besnard, un prêtre en révolution, Souvenirs d'un nonagénaire, PUR (2011) et Journal d'un chanoine du Mans, Nepveu de La Manouillère, PUR (2013)
Tous deux poursuivent leurs recherches au sein du laboratoire de recherche historique de Le Mans-Université, TEMOS (temps-mondes-sociétés) CNRS FRE 2015.
Mémoires d'un notable manceau au siècle des Lumières
Héritier de la plus importante dynastie de manufacturiers en cires et bougies du Mans, Jean-Baptiste-Henri-Michel Leprince d'Ardenay nous ouvre son coeur à travers ses Mémoires, écrits entre 1801 et 1817, au soir de sa vie.
Juge Consul, membre de plusieurs sociétés savantes dont la Société Royale d'Agriculture, administrateur de l'Hôpital Général, Député de l'assemblée provinciale du Maine en 1787, Secrétaire de l'assemblée de la noblesse du Maine pour les états généraux, Maire du Mans en 1790-1791 et membre du Conseil Général, Leprince d'Ardenay représente l'archétype du grand notable provincial sous l'Ancien Régime, la Révolution et l'Empire.
Son récit nous invite à un voyage dans l'insouciante vie des élites du siècle des Lumières avant que ne s'abatte le terrible orage révolutionnaire. Il nous plonge dans le petit monde des privilégiés d'une petite ville de 15 000 habitants, constitué d'aristocrates, d'anoblis et de grands bourgeois, avides de nouveautés, entreprenants et déjà acquis aux valeurs de citoyenneté, d'utilité publique, d'égalité et de liberté.
Benoît Hubert est professeur d'Histoire-Géographie au lycée Gabriel Touchard au Mans, Docteur en Histoire Moderne. Chercheur associé au Lharmans-Cerhio, il poursuit ses recherches sur les écrits du for privé, les élites urbaines au XVIIIe siècle, la culture et les mentalités négociantes à l'époque des Lumières
Souvenirs d'un villageois du Maine Louis Simon (1741-1820)
Un mémorialiste villageois : en soi, le phénomène est rare. Né en 1741, sous Louis XV, et mort en 1820, donc sous la Resrauration, Louis Simon vécut toute sa vie dans un village du Maine, où il était étaminier, c'est-à-dire tisserand de laine fine, et chtre-sacristain. En 1809, il entrprend d'écrire ses souvenirs de jeunesse.
Et sonrécitg n'est pas un plat recueil de généralités ordinaires. C'est une plongée dans les mentalités de la seconde moitié du XVIIIe siècle , une approche de l'intimité, une découverte de ce qui ne se dit ni ne s'écrit dans lers arvhives auxquelles les historiens ont en général accès. Une large part de son manuscrit est en effet consacrée à « la rande affaire de sa vie » , son histoire d'amour avec Nannon Chapeau. Le reste conte l'éphèmère escapade qui en 1763 l'amena à Paris et à Versailles, évoque la Révolution au village et l'épouvante face aux chouans, récapitule les nouveautés papparues durant sa vie, dispense des conseils pour mieux vivre...
Au fil de la plume de Louis Simon,on entend la voix directe d'un homme du peuple. Ses pages lumineuse sont une pépite parmi les écrits du for privé, un document d'une valeur inestimable pour les chercheurs, mais aussi un texte qui parle à tout curieux d'histoire et d'humanité.
Initialement publié et analysé en 1984 et 1996 par Anne Fillon (1931-2012), professeure à l'Université du Maine, ce texte extraordinaire est ici réédité au plus proche de sa version originale, éclairé de notes et d'une introduction inédites et enrichi de documents colplémentaires eux aussi largement inédits.
Sylvie GRANGER est enseignante-chercheuse en histoire moderne à l'Université du Maine. Benoît HUBERT est docteur en histoire moderne. Tous deux sont membres du Centre de Recherches Historiques de l'Ouest (CERHIO-UMR 6258). Ils ont déjà publié aux PUR le journal d'un chanoine du Mans, Nepveu de La Manouillère, 1759-1807 (2013)
Un prêtre en Révolution
François-Yves Besnard (1752-1842) nous livre à travers ses mémoires le témoignage d'un homme à la trajectoire déviée ; un curé aux prises avec la Révolution, un manufacturier malheureux, un acteur de la vie politique dans la Sarthe et un arboriculteur reconnu.
Les « Souvenirs d'un nonagénaire », restitués pour la première fois dans leur intégralité, sont rédigés à l'extrême fin de sa vie. Cet écrit hybride, entre mémoires et confessions, témoigne d'une époque ouverte à tous les possibles, à la jonction des époques moderne et contemporaine.
La lecture de ses mémoires nous convie à la naissance du citoyen Besnard pétri par les Lumières. Besnard fait le pari d'une société éclairée. Ce notable rural privilégié qui voit le monde de manière idéalisé, se transforme en acteur. Le Directoire, après Thermidor, dessine un avenir conforme à ses idéaux. Besnard , républicain modéré, expérimente son rêve de construction d'une société nouvelle. Il est d'abord un intermédiaire entre Paris et la Sarthe puis il est imposé par ses amis La Réveillère-Lépeaux et Volney à la tête de la municipalité du Mans et du département de la Sarthe. Usé, dépassé, il disparaît de la scène publique en mai 1799.
Sous la plume de François-Yves Besnard renaît la douceur de l'Ancien Régime, d'abord au prieuré de Saint-Aubin des Alleuds en Anjou puis au séminaire d'Angers et enfin à la cure de Nouans dans le Maine. La lecture de ces « Souvenirs » est indispensable pour mesurer le schisme provoqué par la Constitution Civile du Clergé, et comprendre les luttes politiques sarthoises sous le Directoire.
François-Yves Besnard, acteur local, témoin discret des personnages politiques à la tête du pays, permet, de son point de vue, une relecture de la Révolution.
Martine TARONI, Docteur en Histoire Moderne, chercheur associé au Cerhio auteur d'une thèse François-Yves Besnard, 1752-1842, un prêtre en Révolution, poursuit ses recherches sur le for privé, la culture et les sensibilités politiques pendant la Révolution.
Ajouter un commentaire